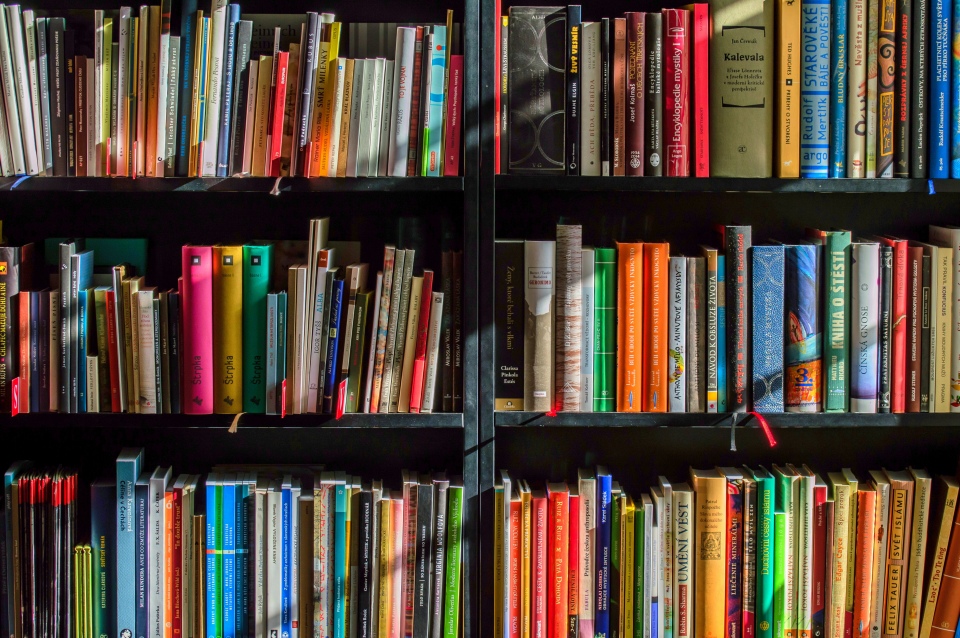| Tags | langage oral, TSA |
|---|---|
| Titre original | Systematic Review of Interventions Based on Gestalt Language Processing and Natural Language Acquisition (GLP/NLA): Clinical Implications of Absence of Evidence and Cautions for Clinicians and Parents |
| Auteurs | Bryant Lucy, Bowen Caroline, Grove Rachel, Dixon Gaenor, Beals Katharine, Shane Howard, Hemsley Bronwyn |
| Date de publication | 2025 |
| Revue | Current Developmental Disorders Reports |
| Lien Source | https://doi.org/10.1007/s40474-024-00312-z |
Introduction:
Une estimation de la prévalence des personnes avec un TND décrites comme “non verbales”, “peu verbales” ou “non oralisates” serait autour de 25% (Rose et Al. 2016).
La CAA met l’accent sur la fonction de la communication, quelle que soit sa forme (parole, gestes, supports visuels). Il est important pour les cliniciens de déterminer non seulement les compétences et capacités de la personne, mais aussi les limitations ou défis affectant la communication, ainsi que les opportunités et les obstacles dans l’environnement. De nombreuses interventions basées sur des preuves existent pour aider les personnes autistes à communiquer.
La demande de soins neuroaffirmatifs et respectueux de la neurodiversité est croissante en orthophonie. Ces pratiques considèrent que les différences entre personnes neurodivergentes et neurotypiques ne sont pas des troubles à corriger mais des caractéristiques impliquant à la fois forces et défis. Toute intervention devrait reconnaître les compétences, forces et préférences de la personne et ne pas considérer les différences de communication comme un trouble à remédier. Les approches neuroaffirmatives valorisent ces différences comme faisant partie de l’identité, des intérêts et de la personnalité de la personne.
Cette perspective a récemment été soulignée dans une revue systématique sur l’écholalie, qui a mis en avant la nécessité pour les cliniciens de reconnaître les fonctions communicatives de l’écholalie plutôt que de chercher à la réduire (Blackburn et al., 2023).
Donc si vous vous demandiez pourquoi on est partis sur une tangente pour parler des pec neuroaffirmatives, c’est pour cela. Les défenseurs des PEC GLP et NLA mettent parfois en avant le fait que seules leurs méthodes sont respectueuses.
Focus sur le GLP et NLA:
Cette revue a été motivée par l’observation par les auteurs de la croissance récente et rapide d’un mouvement promouvant la description par Marge Blanc du Gestalt Language Processing (GLP) et de la Natural Language Acquisition (NLA). La NLA est la description proposée par Blanc du processus d’acquisition du langage chez certaines personnes autistes décrites comme des “traitant le langage de façon gestaltique”. Le concept de traitement gestaltique du langage est apparu pour la première fois en 1977, lorsque Ann Peters a décrit deux types d’expression du langage “gestalt” et “analytique” pour rendre compte du langage d’un enfant qui utilisait à la fois des mots isolés et des unités de langage plus longues . Prizant a ensuite discuté de la production de “blocs” de mots chez des personnes autistes, produits sans analyse consciente de leurs composantes et a utilisé le terme de “traitement gestaltique” pour décrire ce langage, en soulignant sa proximité avec l’écholalie, notamment l’écholalie différée. Prizant a ensuite proposé une théorie de l’acquisition du langage en quatre étapes, tout en précisant que ces “étapes” étaient une commodité de présentation, sans prétention à une réalité psychologique. Depuis, aucune étude longitudinale ou théorique ne semble avoir été publiée pour renforcer les bases de cette hypothèse.
Trente ans plus tard, l’orthophoniste Marge Blanc a publié un ouvrage qu’elle présentait comme un manuel de référence sur l’acquisition du langage. Elle a également publié un protocole pour guider les cliniciens et les parents. Mais les bases théoriques du travail de Blanc restent floues. Dans un éditorial récent favorable au GLP/NLA, Haydock et al. ont décrit ces approches comme neuroaffirmatives, valorisant tous les modes de communication des personnes autistes. Haydock précisait que les stratégies issues des étapes de la NLA favorisent un développement “probable” du langage en proposant des gestalts ayant une signification situationnelle ou émotionnelle forte, susceptibles d’être réutilisés en contexte et de se développer en formes plus créatives et complexes.
Après analyse des travaux de Peters, Blanc et Haydock, les auteurs de cette revue considèrent que la théorie de l’acquisition du langage ne soutient pas la conceptualisation en six étapes proposée par la NLA. Peters avait d’ailleurs souligné que la distinction entre traitement “gestalt” et “analytique” n’était pas naturelle et que les enfants utilisent différents types d’unités linguistiques selon leurs besoins. Elle reconnaissait les limites de sa théorie, qui en était à ses débuts et appelait à la prudence avant toute conclusion ou application clinique.
Des auteurs ultérieurs ont critiqué les fondements théoriques de la NLA, les jugeant faibles et non testés, pointant une classification binaire (gestalt versus analytique), l’absence de critères clairs pour identifier un “GLP” et des estimations douteuses de la prévalence de l’écholalie basées sur des sources secondaires ou tertiaires, parfois quatre fois éloignées des données originales (ex. Blanc et al. affirme que “85 % des enfants autistes utilisent l’écholalie”).
Enfin, d’un point de vue linguistique, la théorie NLA est remise en question, car la recherche montre que l’acquisition de la syntaxe nécessite la maîtrise d’un nombre critique de mots (noms, verbes, adjectifs) plutôt que de “gestalts”. Les gestalts, même atténués, sont appris de façon situationnelle et ne permettent pas le même développement syntaxique que les mots, qui sont acquis dans divers contextes syntaxiques et communicatifs.
Face à ces critiques et à l’absence de données solides sur la validité et l’utilité clinique du GLP/NLA, les auteurs ont souhaité réaliser cette revue pour fournir des informations fondées sur les preuves aux étudiants en orthophonie, aux cliniciens et aux parents qui entendent parler du GLP/NLA, notamment via les réseaux sociaux, blogs, podcasts ou webinaires.
Méthodologie:
Là, les auteurs nous détaillent la méthodologie de leur revue systématique, très habituelle mais nécessaire pour montrer que le travail a été fait en règle (les conclusions nous montrent pourquoi c’est important de montrer qu’ils ont été exhaustifs).
L’étude a été préenregistrée, la méthode de revue choisie est PRISMA… Recherche systématique réalisée le 18 mars 2024 dans de nombreuses bases de données (Cochrane, CINAHL, ERIC, Embase, MEDLINE, PsycINFO, Web of Science, etc.), bases d’éditeurs (Sage, Elsevier, Taylor & Francis, Wiley), registres d’essais cliniques (EU, ANZCTR, ClinicalTrials.gov) et via Google Scholar.
Les termes de recherche incluaient : “gestalt language”, “gestalt processing AND language”, et “natural language acquisition AND echolalia”, appliqués aux titres, résumés, mots-clés et texte intégral. Des alertes automatiques ont été mises en place pour capter de nouvelles publications, et des recherches complémentaires sur internet ont permis de récupérer des documents auto-publiés (Communication Development Centre). Enfin, un appel à littérature grise a été lancé via l’ASHA.
Critères d’inclusion:
Les études ont été incluses si elles :
Elles ont été exclues si :
Résultats et discussion:
Aucune étude empirique rigoureuse (publiée ou non) n’a été trouvée qui démontre que ces approches améliorent l’acquisition du langage, la communication ou le comportement des personnes avec troubles de la communication. Lol
Les informations disponibles sur le GLP/NLA sont principalement des descriptions, des témoignages ou des commentaires, mais pas des données issues de recherches contrôlées. Cette absence de preuves est préoccupante, car la méthode est largement promue depuis 2021 sur les réseaux sociaux et par des formations en ligne.
Les auteurs insistent sur le fait que le temps et l’argent des familles et des cliniciens doivent être investis dans des interventions ayant fait preuve d’efficacité. De plus, utiliser une intervention sans preuve d’efficacité peut causer du tort (perte de temps, de ressources, d’opportunités de progrès pour l’enfant). Et enfin, les choix faits par les familles doivent être éclairés par des preuves fiables, pas seulement par des témoignages émotionnels ou du marketing.
Les professionnels de santé et de l’éducation ont une responsabilité éthique importante. Ils doivent évaluer de manière critique les fondements théoriques et les preuves disponibles avant de mettre en œuvre une intervention auprès des enfants. Lorsqu’ils choisissent d’utiliser une méthode qui ne repose pas sur des données probantes, il leur incombe de justifier ce choix et d’assumer la responsabilité des résultats obtenus.
Enfin, il existe déjà des approches validées et neuroaffirmatives pour soutenir le développement du langage chez les enfants autistes. Celles-ci mettent l’accent sur le respect de l’initiative de l’enfant, de ses modes de communication, de ses forces et de ses centres d’intérêt, en privilégiant des contextes qui ont du sens pour lui. Parmi ces approches, on retrouve les interventions basées sur le jeu, la modélisation avec des outils de Communication Alternative et Améliorée (CAA) ainsi que les méthodes de stimulation du langage dirigées par l’enfant.
Il est nécessaire de faire des recherches indépendantes sur le GLP/NLA pour déterminer quels enfants pourraient en bénéficier et avec quels résultats, avant de recommander son utilisation généralisée.
Les auteurs nous laissent avec un petit aide mémoire et des conseils pour notre clinique qui, à mon sens, peuvent être transposés à d'autres pratiques domaines en orthophonie:
Implications Cliniques
L’absence de preuves scientifiques sur l’efficacité du GLP/NLA a plusieurs conséquences importantes pour la pratique clinique. Les auteurs soulignent l’urgence de :
Pistes pour les recherches futures:
Pour orienter les recherches futures sur le GLP/NLA, il apparaît essentiel de commencer par un travail théorique solide. Avant même d’évaluer l’efficacité de cette approche, il convient d’en examiner les fondements et d’en justifier les principes.
Appliquer un protocole dont les bases ne sont pas clairement établies comporte un risque : celui de priver des enfants d’interventions validées, qui enseignent réellement le langage. Par ailleurs, certains choix opérés par les créateurs du GLP/NLA manquent de justification, notamment l’idée qu’il faudrait cesser d’enseigner les mots, les phrases ou les verbes, alors qu’ils constituent des éléments essentiels de l’acquisition du langage. Une autre piste de recherche consisterait à comprendre comment un modèle théorique limité a pu devenir un véritable “mouvement”, largement relayé par des formations, des podcasts et les réseaux sociaux, sans disposer de preuves scientifiques solides. Il serait également pertinent d’explorer l’adhésion des cliniciens : appliquent-ils le protocole de Blanc dans son intégralité ou seulement en partie, et quels en sont les résultats ?
Enfin, les expériences de terrain doivent être documentées, afin de comprendre pourquoi certains cliniciens adoptent puis abandonnent le GLP/NLA et pour identifier les effets négatifs éventuels, les risques et les échecs rencontrés.